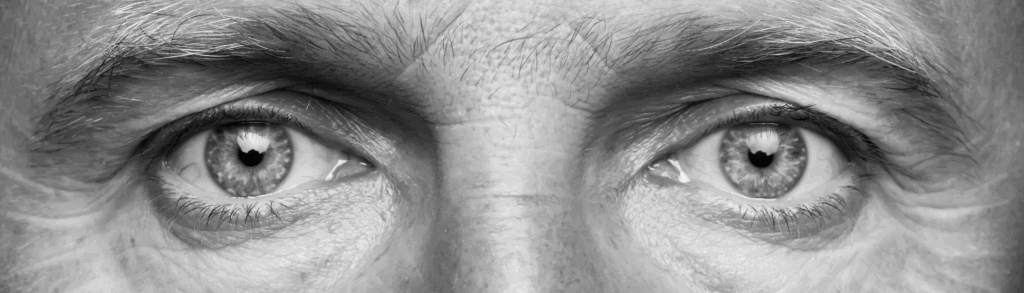C’est un paradoxe troublant. Alors que nos sociétés n'ont jamais été aussi avancées sur le plan médical, l'espérance de vie progresse de moins en moins vite. C’est ce que révèle une étude publiée dans Nature Aging en montrant un net ralentissement de cette espérance de vie dans des pays comme le Japon, la France, la Corée du Sud, l'Australie, ou encore la Suède.
L'espérance de vie en panne
Dans ces régions actuellement, c’est en effet autour de 85 ans qu’oscille la durée de vie moyenne — 88 ans pour les femmes, 83 pour les hommes. Mais, comme le souligne Jay Olshansky, professeur de santé publique à l'université de l'Illinois et auteur principal de l'étude, depuis 1990, nous n’avons gagné que 6,5 années supplémentaires en moyenne. Soit deux années par décennie. Un rythme en net repli comparé au siècle dernier, où nous gagnions trois années tous les dix ans.
Plus inquiétant encore : cette progression semble s’expliquer davantage par la baisse de la mortalité infantile et juvénile que par un véritable allongement de la vie adulte. Si le nombre de centenaires est donc appelé à croître encore sous l'effet du vieillissement démographique, battre des records comme celui de Jeanne Calment (122 ans) semble en revanche de moins en moins probable. Notre quête collective pour prolonger la vie pourrait donc ainsi, selon certains chercheurs, atteindre sa limite.
Quand la médecine atteint son plafond de verre
Pour autant, il serait faux de considérer ce ralentissement comme une défaite : il consacre au contraire un siècle de victoires contre les grandes causes de mortalité. Grâce aux vaccins, aux antibiotiques et aux mesures d’hygiène, la première moitié du XXᵉ siècle a permis de terrasser les maladies infectieuses. Puis, dans les années 1970, ce fut au tour de la médecine cardiovasculaire de prendre le relais pour prolonger encore la vie.
Aujourd'hui toutefois, ces leviers majeurs semblent à bout de souffle, comme l’explique Gilles Pison, démographe et chercheur associé à l’Ined, pour qui les retombées de la révolution cardiovasculaire sont en voie d’épuisement. Même constat pour Christophe de Jaeger, spécialiste de la médecine du vieillissement, qui rappelle que la mortalité infantile est au plus bas, tandis que l’hygiène et la vaccination sont à leur maximum d’efficacité. Et si, désormais, c’était sur le vieillissement lui-même qu’il fallait agir ? Tel est, semble-t-il, le changement de paradigme actuellement à l’œuvre dans la communauté scientifique : non plus soigner les maladies, mais freiner l'usure biologique des cellules, responsable de leur apparition.
L'âge en bonne santé, nouveau terrain de conquête
Si le nombre d'années vécues n'augmente plus vraiment, celui des années vécues en bonne santé, lui, continue de progresser. En France, selon les données du ministère de la Santé, à 65 ans, les femmes peuvent espérer vivre encore 12 ans sans incapacité majeure, les hommes 10,5 ans. Un progrès discret, mais réel. Dans les laboratoires, la recherche s'oriente donc désormais vers des stratégies de "médecine de longévité" visant à retarder l'apparition des pathologies liées à l'âge. À Montpellier, Jean-Marc Lemaître et son équipe ont ainsi démontré qu’en reprogrammant les cellules sénescentes chez la souris, il était possible de freiner le vieillissement des tissus et d'augmenter la durée de vie de 15 %.
De nouvelles armes contre le "mal vieillir" ?
Côté traitements, deux molécules ont aujourd’hui le vent en poupe : la metformine, médicament antidiabétique ancien, et la rapamycine, une molécule qui, selon des études menées sur des animaux, prolongerait la durée de vie moyenne de 9 % pour les mâles et de 13 % chez les femelles.
À noter concernant la rapamycine : une récente étude de l'université Columbia explore son potentiel pour prolonger la fertilité féminine de plusieurs années, en retardant la ménopause, considéré comme un marqueur biologique du vieillissement. Une piste prometteuse selon Mario Pende, directeur de recherche à l’INSERM, qui pourrait un jour déboucher sur des médicaments capables de retarder l’apparition de maladies comme Alzheimer, l’arthrose ou encore certains cancers.
Source : Cliquez-ici