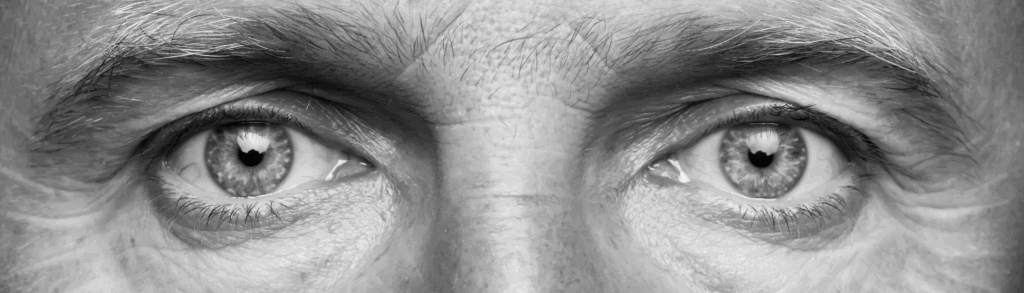Touchant environ jusqu’à 10 % des enfants et 12 % des adultes, en grande majorité des femmes (2 à 3 fois plus que les hommes), la migraine constitue la 2ᵉ cause mondiale de handicap, juste derrière l’AVC selon l’OMS. Pourtant, malgré son impact majeur sur la qualité de vie, elle reste une maladie sous-estimée, minimisée, et surtout mal prise en charge. Si la recherche a permis de mieux comprendre ses mécanismes et de développer de nouveaux traitements, l’accès à ces thérapies innovantes reste aujourd’hui un vrai parcours d’obstacles.
Un mal invisible, un vrai handicap
Non, la migraine n’est pas un simple mal de tête qui passe avec un Doliprane. Il s’agit d’un trouble neurologique complexe, dont les crises peuvent s’accompagner de douleurs violentes, pulsatives, souvent d’un seul côté du crâne, parfois précédées d’une aura. À cela s’ajoutent nausées, vomissements, hypersensibilité à la lumière et au bruit. Ces symptômes, variables selon les personnes, s’étendent souvent sur plusieurs jours, laissant des séquelles de fatigue et de troubles cognitifs.
Distinguer la migraine d’une simple céphalée est essentiel. Il existe plus de 200 types de maux de tête, mais seules certaines – dites céphalées primaires – ne sont pas liées à une autre pathologie. Parmi elles, la migraine se différencie des céphalées de tension par sa douleur plus intense, localisée, aggravée par l’effort et souvent associée à des troubles digestifs.
Un diagnostic difficile
Faute d’examen biologique spécifique, le diagnostic de la migraine repose avant tout sur uninterrogatoire clinique approfondi. Selon la Société Française d’Étude de la Migraine et des Céphalées (SFEMC), notre compréhension des migraines a considérablement progressé. On sait aujourd’hui que le cerveau des personnes migraineuses est hypersensible aux variations internes ou environnementales(stress, hormones, sommeil, alimentation, etc.).
Mais dans les faits, le parcours des patients reste chaotique. Un tiers des malades n’ont jamais consulté un spécialiste. Beaucoup s’auto-diagnostiquent, faute de mieux, ou tombent sur des médecins peu formés, et parfois peu à l’écoute. Résultat : le délai moyen avant un diagnostic correct dépasse parfoisles sept ans. En parallèle, l’automédication masque les symptômes sans s’attaquer à la racine du mal.
Des traitements prometteurs mais… inaccessibles
Longtemps, les traitements disponibles étaient peu spécifiques : anti-inflammatoires, bêtabloquants, antidépresseurs. Bien qu’utiles dans certains cas, ils demeurent inefficaces dans les formes sévères. Dans les années 1990, les triptans ont constitué une avancée : ces molécules soulagent rapidement les crises en agissant sur les vaisseaux crâniens et la libération des substances inflammatoires. Mais elles doivent être prises très tôt et sont contre-indiquées en cas de pathologies cardiovasculaires.
Plus récemment, après des décennies de recherche, les scientifiques ont identifié le rôle clé d’un peptide, le CGRP, dans le déclenchement des crises. Cette découverte a permis le développement de nouvelles molécules dites anti-CGRP, comme les gépants, qui bloquent ce peptide ou son récepteur. Ces traitements, administrés par voie orale, injection ou perfusion, sont mieux tolérés et peuvent être utilisés en prévention ou en traitement de crise. Destinés aux patients les plus sévèrement atteints (plus de huit crises par mois, échec des traitements classiques), ces médicaments représentent un véritable espoir pour les personnes souffrant de migraine.
Une reconnaissance encore en chantier
Environ 50 000 patients seraient éligibles à ces nouvelles thérapies en France, mais les discussions avec les autorités de santé piétinent. Une impasse médico-économique difficilement justifiable pour les malades, souvent en souffrance au quotidien et dont la vie sociale et professionnelle est gravement impactée.
Source : Cliquez-ici