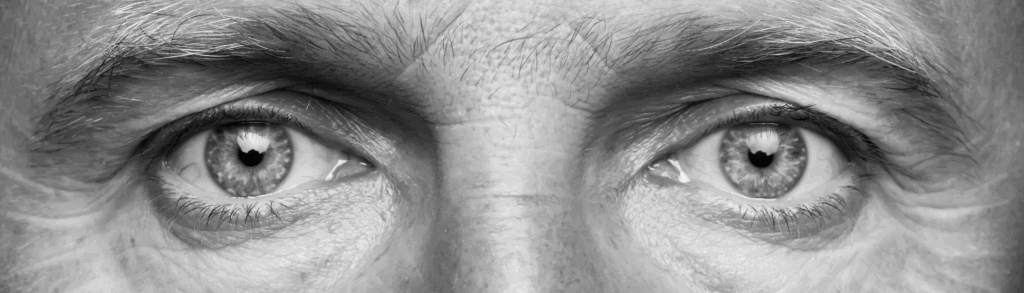En France, une femme sur huit sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Après le choc du diagnostic, une question revient souvent : faut-il s’arrêter complètement de travailler ? Selon la Professeure Mahasti Saghatchian, oncologue à l’Hôpital Américain de Paris, tout dépend de la situation médicale et personnelle : le repos complet n’est pas toujours nécessaire. « Si elles le souhaitent et si elles en sont capables, on encourage les femmes à rester actives, même sous traitement ». Continuer à travailler aide certaines patientes à garder une routine, à lutter contre l’isolement et à préserver une identité autre que celle de « patiente ». Le travail peut ainsi devenir un repère, un espace de lien social et d’estime de soi.
Les bénéfices et les limites du maintien dans l’emploi
Travailler pendant un traitement n’est pas toujours facile : les effets secondaires (fatigue, nausées, troubles de la concentration) peuvent rendre certaines tâches plus compliquées.
Mais pour d’autres, maintenir une activité, même réduite, aide à « rester actrice » de sa vie.
Comme le souligne la professeur Mahasti Saghatchian, le sentiment d’utilité et de reconnaissance professionnelle peut soutenir l’estime de soi et même améliorer le moral, ce qui influe positivement sur la qualité de vie. Il n’existe toutefois aucune “bonne” manière de faire. Certaines femmes préfèrent une pause totale pour se concentrer sur leur santé, d’autres choisissent une reprise progressive. L’essentiel est que la décision vienne de la patiente elle-même, sans culpabilité ni pression extérieure.
Des dispositifs pour adapter son travail
Heureusement, plusieurs aménagements permettent de concilier traitement et vie professionnelle. Le mi-temps thérapeutique (ou temps partiel thérapeutique) est le plus connu. Prescrit par le médecin et validé par la Sécurité sociale, il permet de reprendre progressivement une activité tout en percevant une partie de son salaire, complétée par des indemnités journalières. D’autres ajustements peuvent être proposés avec l’appui du médecin du travail, parmi lesquels : horaires aménagés ou décalés, télétravail, pauses supplémentaires, allègement de certaines missions, reclassement temporaire sur un poste moins physique. L’employeur est tenu de respecter les recommandations médicales, sauf impossibilité justifiée.
Informer ou non son employeur : un choix personnel
En cas de cancer, aucune obligation n’existe de révéler la nature de sa maladie à son employeur. L’arrêt maladie ne mentionne jamais le diagnostic. Cependant, une communication transparente peut parfois faciliter la mise en place d’adaptations concrètes au travail. La décision reste personnelle et dépend de la relation de confiance avec l’entreprise.
Sécurité financière et protection de l’emploi
Pendant un arrêt maladie, le contrat de travail est simplement suspendu — le licenciement pour raison médicale directe est interdit. La salariée conserve son poste ou un emploi équivalent à son retour, avec le maintien de certains droits (ancienneté, retraite, etc.). Si la reprise à temps plein reste difficile, d’autres dispositifs peuvent sécuriser le parcours. C’est notamment le cas de la pension d’invalidité, lorsque la capacité de travail est durablement réduite ; ou de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), qui facilite les aménagements et l’accès à certaines aides professionnelles.
Prendre soin de soi avant tout
Fatigue, stress, charge mentale : travailler pendant les traitements demande une organisation bienveillante. Il est ainsi recommandé de planifier ses journées selon ses moments d’énergie ; de s’autoriser à déléguer ; de faire des pauses régulières ; et de pratiquer une activité physique adaptée, dont les bienfaits sur la fatigue et le moral sont scientifiquement prouvés. Un soutien psychologique (groupes de patientes, psychologue, associations) peut aussi être précieux pour traverser cette période sans s’isoler.
Source : Cliquez-ici