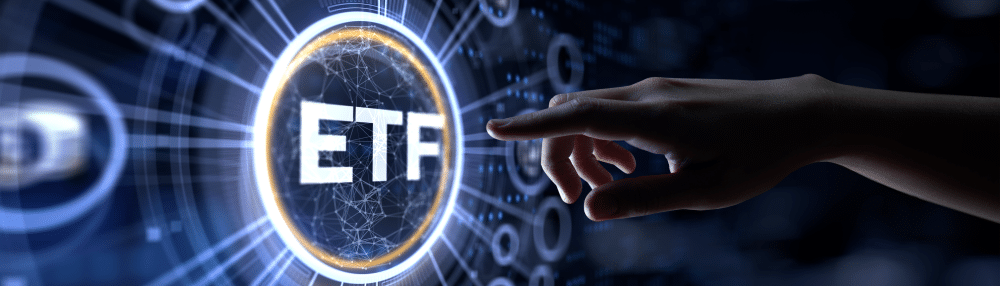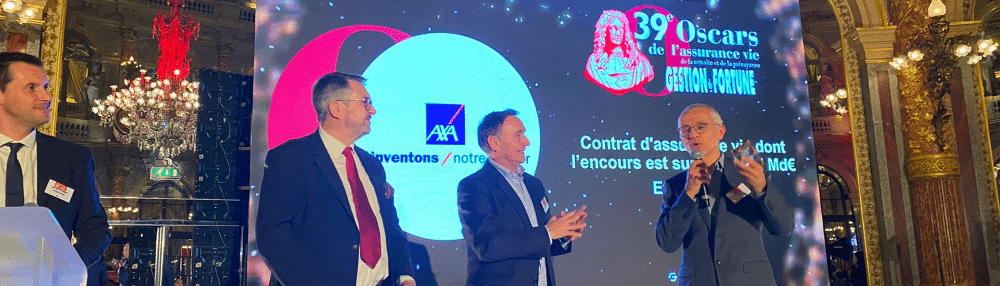Si les intérêts composés constituent une notion financière importante, ils sont pourtant largement méconnus des épargnants. Les intérêts composés (certains parlent aussi de « capitalisation des intérêts ») signifient que les gains issus d’un placement sont réinvestis dans le produit financier en question. En l’absence de retraits, les intérêts génèrent ainsi eux-mêmes des intérêts au fil du temps. C’est ce que l’on appelle « l’effet boule de neige ».
L’effet cliquet
Les intérêts composés jouent pleinement dans les placements dont les intérêts annuels sont définitivement acquis. C’est-à-dire dont les gains obtenus ne peuvent pas être remis en cause, et ce, quelle que soit l’évolution des marchés financiers. Trois familles de produits bénéficient de cet « effet cliquet » : les livrets d’épargne, l’épargne logement et les fonds en euros de l’assurance vie.
Les premiers regroupent les livrets règlementés défiscalisés, tels que le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), le Livret d’épargne populaire (LEP) et le Livret Jeune, ainsi que les livrets bancaires fiscalisés ou comptes sur livret (CSL). L’épargne logement regroupe, elle, le plan épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL). Enfin, le fonds euros constitue l’un des deux principaux supports d’investissement de l’assurance vie, avec les unités de compte (UC). Outre l’effet cliquet, ce support offre une garantie sur le capital (le souscripteur peut récupérer le cumul de ses versements à tout moment), tout comme les livrets d’épargne et l’épargne logement.
Une augmentation exponentielle
On savait intuitivement le bénéfice des intérêts composés. Le premier rapport de l’Observatoire des produits d’épargne financière (OPEF), publié le 1er juillet 2025, vient le confirmer, chiffres à l’appui. Créé par la loi Industrie verte du 23 octobre 2023, l’OPEF a été mis en place au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Lui-même instauré par la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière, le CCSF est chargé d’étudier les relations entre les acteurs financiers (banques, assureurs, sociétés de gestion…) et leurs clients. Composés de représentants des fédérations professionnelles et des associations de défense des consommateurs, de parlementaires et de personnalités qualifiées, il donne des avis sur les pratiques du marché.
Pour expliquer le fonctionnement des intérêts composés, l’OPEF prend le cas fictif d’un particulier, qui investit 1.000 euros sur un placement délivrant un rendement annuel de 3 %. En partant de l’hypothèse que l’épargnant ne retire aucune somme, le gain sera de 30 euros (1.000 euros x 3 %) à la fin de l’année, soit un encours (le versement majoré des gains) de 1.030 euros (1.000 euros + 30 euros). L’année suivante, les 3 % d’intérêts annuels ne seront pas calculés sur la base de 1.000 euros, mais sur celle de 1.030 euros. Les gains s’élèveront donc à 30,90 euros (1.030 euros x 3 %). Ce qui aboutira à un encours de 1.060,90 euros (1.030 euros + 30,90 euros). Et ainsi de suite...
Un biais cognitif
Au bout de 20 ans, l’épargnant aura, toujours d’après les calculs de l’OPEF, accumulé 1.806 euros à partir de son investissement de départ de 1.000 euros. Il aura donc gagné 806 euros, sans effort financier supplémentaire. Cette somme est exprimée en euros brut, sachant que des frais de gestion, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux peuvent s’appliquer sur le gain réalisé selon le placement choisi.
Si l’exemple mentionné dans le rapport de l’OPEF relève de la fiction (les taux d’intérêt ou de rendement varient dans le temps), il a le mérite de montrer l’augmentation exponentielle des intérêts composés. Pour l’OPEF, les épargnants ont tendance à ne pas avoir conscience de cet effet particulièrement bénéfique pour leurs économies. L’Observatoire qualifie ce biais cognitif de « biais de croissance exponentielle ». « Pour les investissements, cela signifie que les investisseurs ont tendance à sous-estimer les valeurs futures », regrettent les auteurs du rapport.
Source : Cliquez-ici